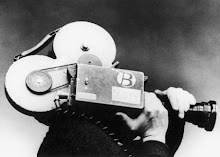C'est une jeune femme, recouverte d'un plaid sur la tête et illuminée par la lumière d'un écran. Elle a trois rêves : celui d'être en forme, à la mode et riche. Mais cela ne se fera pas sans difficulté. Sa maison en forme d'oeuf va au fur et à mesure se craqueler jusqu'à se détruire.
Katherine Sarpi met en lumière son personnage en le rendant pathétique et attachant. On ne peut s'empêcher de compatir pour ce personnage qui semble se rapprocher de l'humain par sa faiblesse et son acharnement à la réussite. Ici, la réalisatrice semble dénoncer le mal-être entraîné par l'obsession de l'image. Dès lors, elle met en avant le superficiel qui guide notre société. Ici, la protagoniste attache plus d'importance au regard des autres qu'à son bien-être. Elle affirme d'ailleurs :« l'argent arrangera tout ».
Par ailleurs, le style de la réalisatrice est intéressant, déstabilisant et original. En effet, ces traits rapides et nombreux donnent de la matière et insistent sur le foisonnement d'objets faisant ressortir un sentiment d'enfermement. Les dessins ne sont pas détaillés et ce sont principalement les nuances du noir au blanc, passant par le gris qui créent l’environnement dans lequel Peg évolue. Elle insiste sur une esthétique qui est loin d'être satisfaisante pour le spectateur, il y a beaucoup de blanc, donnant presque l'impression que le dessin n'est pas fini, les aplats ne sont pas lisses comme on le remarque en 2'6.
La manière dont la dessinatrice représente le personnage atteste d'un côté engagé voir féministe. En effet, entre un tas de vêtement et des chaussures en vrac, l'image de la femme est remodelée. Notre personnage tombe. Elle galère, elle persévère mais n'y arrive pas. En une image, que l'on retrouve a 2'28, nous voyons la situation tragique de la jeune femme gisant au sol dont le burlesque est accentué par le bruitage. Mais elle n'est pas représentée comme dans le cinéma classique hollywoodien qui a encore une grande influence dans le cinéma commercial contemporain notamment. La réalisatrice préfère le parodier. On voit la jeune femme s'écraser comme une crêpe, gisant sur le sol laissant dépasser ses bourrelets, elle porte une large culotte dont l'élastique fait ressortir son ventre et ses seins vont dans tout les sens quand elle court au ralentit.
Tout en nous racontant cette histoire attachante et grotesque, Sarpi nous fait apparaître des plans originaux comme celui du personnage, qui, d'un regard subjectif observe son corps après que l'homme lui ai fait remarquer qu'elle ne ressemble à rien (1'37). Dès lors, elle nous fait remarquer que le dessin n'est pas seulement une image fixe mais peut créer un récit mobile. Pour cela, elle utilise un langage cinématographique. On peut le voir avec la profondeur de champs qui laisse parfois apparaître un léger flou, la musique extradiégétique, cet envie de vouloir représenter la vitesse et la voix-off.
Enfin, il est pour moi, important de parler de la séquence finale dont le chaos est personnifié par la profusion d'objets. Un travelling haut-bas suivit d’un plan américain nous montre cette masse dominante à moitié nue laissant apparaître un sentiment de sérénité certain. Le plan arrêté sur celle-ci regardant sa feuille entraîne une certaine tension. La liberté prend finalement sens lorsque celle-ci décide de renaître et lâche prise, laissant ainsi apparaître une véritable force à côté de sa maladresse attachante.
Au final, Habits est un huit-clôt émouvant de part sa dimension lyrique et pathétique. Il semble mettre un point d'honneur à la difficulté de changer nos habitudes et raconte l'histoire d'une jeune fille belle et brave, mené par l'envie de changer. Seulement, elle n'arrive pas au bout de son rêve, dont le cœur est aveuglé par l'envie de plaire. C'est finalement par un commencement que le film se conclut : l'éclosion de son œuf. C'est pour ma part, une manière ingénieuse de terminer cette oeuvre qui montre la perte comme un renouveau.
Pauline Lailvaux, AS1