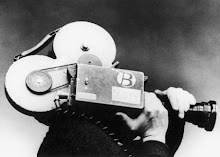Les cochons tatoués de Wim Delvoye
Aussi abscons que cela puisse paraître nous sommes en présence, selon l'artiste:"d'une friction entre l'art et la vie". Si tel est l'essence de ces œuvres nous n'en ressentons aucunement l'effet. On aimerait presque que ces cochons prennent conscience de leur statut chic et s'élèvent mais hélas...
Ce que nous reprochons à Wim Delvoye est la transposition d'une pratique humaine courante à un animal, devenant de ce fait une oeuvre d'art incontestable. C'est cette stagnation séculaire de l'art qui nous préoccupe, les choses sont surprenantes sans l'être vraiment. La démarche fait réagir plus qu'elle n'interroge mais elle trouve un public.
Dans notre cas c'est une profonde indifférence qui nous prend et nous pousse une fois encore à critiquer ce pan de l'art contemporain qui génère cette indifférence a posteriori révoltante. Pourtant bien traités dans la ferme de leur propriétaire, on ne peut s'empêcher d'être empathique envers ces êtres dépourvus de subjectivité.
Cela aurait pu être une tradition tribale millénaire que ça en serait tout aussi risible et auquel cas on assisterait à une redéfinition de cet acte comme art primitif assez interlope, sans vouloir l'entraver car pratiqué par un groupe depuis des générations. Mais le statut de l'artiste étant ce qu'il est, les stimulus s'en vont virevoltant piquer les réactionnaires et émerveiller les éponges au fort pouvoir absorbant.
Un pH de 4,2 animait cette critique.
Adèle Normand AS1
Ibrahim Touhami AS1