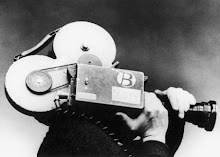Room : Le grand monde
de Jack
Une mère et son enfant
sont enfermés dans ce qu’ils appellent la « Room ».
Par qui, pourquoi, nous n’avons pas tout de suite les clés. On
découvre leur quotidien au sein de cet espace clos, qui est le seul
univers pour Jack, l’enfant, n’ayant connu que la « room »,
les histoires racontées par sa mère, et la télévision. Un
quotidien structuré par une mère, Joy, désirant donner quelques
repères à son fils. Un jour, elle prend la décision de s’enfuir,
et c’est son fils qui assumera cette responsabilité…
Filmé comme un huit clos
étouffant, le film se découpe en deux parties, plutôt inégales.
Un début dans la « room » trop bref, ne nous montrant
pas assez la temporalité vécue par les personnages. De plus, la clé
de l’intrigue est dévoilée assez rapidement, par un monologue qui
arrive de nulle part, subtilité aucune.
Malgré tout, dans
cette partie, la room est filmée comme un monde à part entière,
grâce au point de vue de Jack, l’enfant : le parti pris,
justement, est de filmer une histoire sordide d’un point de vue,
innocent, naïf. Le réalisateur ne cherche pas à se concentrer sur
le passé de la mère (on ne voit ni les viols, ni le kidnapping
etc.) là ou d’autres auraient pu nous écraser de flashback
larmoyants. Cependant, avec un tel sujet, on ne peut échapper à un
pathos tout en violons et ralentis. Mais mention spéciale à
l’actrice Brie Larson tout en retenue et subtilité et à l’enfant
joué par Jacob Trembley qui porte une grande partie du film sur ses
épaules.
Dans cette première
partie, « Old Nick » (la présence hostile et ambiguë)
est au premier abord « caché », seulement vu à travers
les yeux de l’enfant. Malheureusement, ce parti prit audacieux et
balayé par une mise en scène classique. N’aurai il pas été
mieux de garder son identité incertaine ? Surtout qu’il vite
éclipsé, le centre du film étant la relation mère-fils.
La seconde partie
s’attache à raconter l’après. Comment pour l’enfant découvrir
un monde dont il ne connaît rien, et comment pour la mère se
reconstruire dans un monde qui lui était familier et qui est lui
devenu étranger. La difficulté aussi pour l’entourage, lui aussi
traumatisé par cette expérience, et qui doit apprendre à accepter
l’enfant. Jack est issu d’un viol, et le scénario ne l’oublie
pas.
Le point de vue de
l’enfant reste omniprésent : il ne cesse d’être en marge
dans ce monde qui est n’est pas le sien : il ne sait pas
communiquer, il a perdu ses repères. Il demande régulièrement à
rentrer chez lui : la room. La dernière vision de cette pièce
sera celle d’une chambre exigüe, alors que la mise en scène de
départ nous la faisait voir comme étendue. C’est encore grâce au
parti prit du point de vue de l’enfant : maintenant qu’il
connaît le monde, son ancien univers lui paraît bien fade.
Une réflexion sur
l’enfermement physique autant que moral est posée : ils
sortent d’une certaine zone de confort, pour se cloisonner dans ce
nouveau monde : même lorsqu’ils sont dehors, ce n’est qu’à
travers une fenêtre qu’on les voit. La réalisation dépeint ce
nouvel cloisonnement : ils sont toujours enfermés par le cadre.
Même s’ils sont sauvés, libres, ils restent enfermés moralement.
Une question se pose
aussi sur les médias et leur récupération d’affaires sordides :
contrainte d’acceptée une interview glauque, intrusive et qui
s’infiltre les émotions, Joy sera détruite par la vision
extérieure de son histoire.
Le film oscille entre
drame psychologique et thriller : la scène principale, qui se
trouve au milieu du film est un tour de force narratif et esthétique.
Angoissante, vécue de l’intérieur par les yeux de l’enfant,
elle est à la fois signe de liberté (seul moment où l’on est
vraiment à l’extérieur) et inquiétante, réalisée comme un film
à suspense. Room est un film dérageant, bouleversant de réalisme,
avec une réalisation soignée malgré quelques intrusions
larmoyantes et incongrues. Une jolie réussite.
Alice Pasquet –
Juliette Vandorpe