L'opacité s'estompe devant des corps immobiles.
Un jeu de matières créé par la lumière, un espace qui verra des corps prendre vie et s'abandonner dans une transe souple et frénétique.
Un engagement physique des danseurs dans un rituel où le spectateur s'immisce en traversant la froideur d'un écran et un vent glacial faisant la liaison entre le plateau et la salle.
Sur les reproductions des improvisations musicales de Martin Schütz au violoncelle électrifié, s'appuient deux voix antagonistes. L'une est chaude et massive, l'autre psychédélique. Sur ces sons harmonieux et dissonants, des corps légers s'assemblent, s'organisent jusqu'à former des silhouettes improbables, bestiales ou machiniques.
A travers le filtre devenu imperceptible s'entrecroisent et se brouillent des formes et des voix, jusqu'à créer un langage étrange : un anglais rythmique et musical, psalmodié par Dorothée Munyaneza et appuyée par les acrobaties vocales de Graham F. Valentine, ouvre aux auditeurs les porte d'un monde fait de sonorités nouvelles. La frustration de ne pas comprendre le texte dans son ensemble laisse place au plaisir innocent des oreilles.
(Nous entendrons certains se plaindre du fait que cet « opéra » n'était pas sous-titré, mais une fragmentation de plus dans le regard aurait été invivable.)
La danse est fragmentée par la lumière et par un rideau noir aux allures de fantôme derrière lequel disparaissent des morceaux de mouvements. Les projecteurs dessinent des espaces dans lesquels sont enfermés des danseurs et des danseuses tourmentées. Cette partie du spectacle est celle qui m'a le plus marqué, notamment lorsqu'un danseur s'accroche au rideau qui lui d'appui pour tourner autour du corps désorienté de la danseuse. Lorsque ses pas s'allègent et deviennent presque imperceptibles, il quitte le sol sans vraiment s'envoler.
Le spectacle ICE de François Verret est plus à ressentir qu'à comprendre. En stimulant l'intimité du spectateur, il parvient à nous capturer dans un monde glacial reflet de la terreur du fantasme masculin. Parfois insupportable, l'intensité de ce spectacle est telle qu'on a seulement deux possibilités : entrer dans l'univers de Verret ou rester planté sur son fauteuil pendant 1h30 (moi, je suis partie avec eux). L'espace temps dans lequel on nous propose de voyager est fragile, le spectateur est happée par cette spirale mais à la moindre occasion rappelé sur Terre.
Verret dans cette mise sur scène du texte d'Anna Kavan, Ice, développe un point de l'ouvrage : la libération des pulsions. Il se garde de montrer une vision du monde actuel et serait incapable d'expliquer entièrement sa démarche car certains choix découlent de l'arbitraire. Il fait cependant de cet instant à l'opéra de Lille un sujet de questionnement sur le passage du temps et sur les réalités de notre monde.
Devant Ice, j'ai ressenti tout le paradoxe que pouvait offrir une même représentation, a de nombreuses reprises j'ai ressenti simultanément des émotions opposées. La critique d'Aurore KROL (Les Trois Coups) rejoint la mienne :
"C’est assez incroyable comme le vide peut devenir architectural, comme l’étendue renvoie au manque, à l’instant vertigineux où plus rien ne subsiste pour se raccrocher."
Aucun contact ne reste avec la réalité et seuls les paradoxes de cette représentation se font ressentir.
Cette expérience d'un spectacle de danse contemporaine, qui était la première, m'a fait découvrir la relation qu'entretiennent les danseurs avec le sol, et je salue la performance des artistes qui se tordent et se perdent dans des mouvements que je n'aurai pas pu concevoir auparavant. Je n'ai put raccroché ce spectacle à aucune autre forme artistique, car c'était pour moi une expérience unique.
Marie Vuylsteker AS1
mardi 11 mai 2010
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
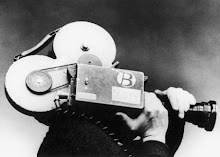
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire