Ginny est un court métrage fort. Susi Jirkuff qui est, rappelons-le, artiste plasticienne réussit à dépeindre dans un temps très court ( moins de 5 mn) une société maussade et confuse. Ginny n’a aucune capacité d’empathie excepté pour ceux qui lui sont proches. Elle n’a aucune capacité de jugement non plus. Elle se laisse entraîner par le mouvement sans jamais avoir de regard critique. A la question du psychiatre « what do you think ? » elle répond « think ? » comme si le mot même lui était étranger.
Ce qui frappe dans ce court métrage, se sont d’abord les dessins quasi monochromes de Jirkuff représentants des barres d’immeubles toutes semblables les unes aux autres. Elle nous dépeint les abords d’une cité labyrinthique ainsi que son intérieur délabré. Les dessins s’enchaînent parfois d’un rythme frénétique, d’autres fois sur un rythme lent et mesuré. Les buildings se substituent les uns aux autres, une fenêtre apparaît ; parfois l’ombre du chat surgit, seul élément de vie. Ce qui interpelle également ce sont les voix. Les personnages ne sont présents que par le biais des voix off. Lente, chaleureuse et posée pour le psychiatre ; légèrement cassée, et zozotante pour Ginny. La candeur de sa voix frappe d’autant plus compte tenu de l’horreur du sort qu’elle et ses amis ont fait subir au chat. Ce chat jeté à quatre reprises du haut d’un immeuble afin de pouvoir capturer au mieux sa chute grâce à une caméra. La vidéo comme gag que l’on montre à ses amis, de manière décomplexée et déconnectée de ce qui se joue à l’écran.
Je trouve que Susi Jirkuff se saisit ici d’un sujet de société très moderne. La jeunesse qu’elle illustre dans son court métrage est déconnectée. Déconnectée du monde qui l’entoure, déconnectée de tout savoir vivre, déconnectée des autres, déconnectée de toute forme de pensée. Elle n’a pas de but, pas d’objectifs, elle cherche à conjurer l’ennui. Et cela passe par la transgression : brûler l’ascenseur, brutaliser un chat. Mais cette jeunesse n’a pas conscience de la répercussion de ces actes en témoigne la dernière phrase prononcée par Ginny « mais il était vivant quand nous sommes partis ».
Jirkuff ne porte pas de jugement, elle montre la situation telle qu’elle est. Le premier réflexe du spectateur est de s’indigner face au sort du chat martyr. Mais le sort de Ginny et de son ami Lee est tout aussi triste. C’est Ginny qui pointe du doigt cette situation injuste d’une société qui empêche son ami de travailler à cause d’un chat. Une société qui fait le choix du chat plutôt que de l’humain. Cette jeunesse sans avenir, sans perspective, sans réflexion c’est là qu’est la véritable tragédie du court métrage. Quel avenir pour cette fillette égoïste qui évolue dans cet environnement médiocre ?
Susi Jirkuff nous parle des oubliés de notre société. Ils paient leurs impôts, font partis de notre système, votent ; mais nous détournons le regard par horreur de ce qu’ils nous inspirent. Elle dénonce une humanité en danger.
Adèle Lagarrigue
Ginny, de Susi Jirkuff est un court métrage très sobre et pourtant très riche. Au rythme de la voix espiègle de la petite Ginny, nous voyageons dans sa banlieue. Ici, on ne s’embarrase ni de personnage, ni de mouvement, ni de fantaisie dans l’expression picturale du récit. Des barres grises et c’est tout.
De manière très efficace, Jirkuff nous immerge dans une banlieue anglaise. Si on suppose qu’il s’agit d’un décor britannique c’est parce que l’accent de la petite fille nous oriente, mais entre ces dessins et la banlieu française, finalement c’est la même chose. Des même batiments sur des planches de dessins qui se ressemblent toutes, c’est avec simplicité que l’artiste attire notre attention sur la monotonie et la froideur de ces quartiers. Le dédale de béton est le théatre de l’ennui, de la lassitude, et de leurs conséquences. Ginny raconte le supplice d’un chat avec une légèreté qui nous aggresse. Comme si il s’agissait d’une simple filouterie, la petite fille énonce étape par étape la mise en place du lancé de chat.
Dans cette courte entrevue avec un psychologue, Ginny donne vie au cauchemar de milliers de personnes. Elle et ses amis jettent un chat du haut d’un immeuble à quatre reprises pour s’amuser. On ne peut pas ignorer la fascination grandissante pour les chats qui envahie notre société. Les petits félins reignent sur internet et plus précisément sur les réseaux sociaux. On peut difficiliment passer une journée sans voir défiler des vidéos de chatons « trop cute » ou de gros matous déguisés en pirate. En faisant d’un chat la victime de l’ennui, Jirkuff porte un regard très critique sur l’organisation de notre société. Les chats sont surexposés, ils deviennent des chefs d’entreprise et de véritable star. Et dérrière les écrans où les chats sont sacrés, les jeunes des banlieues sont invisibles. La petite Ginny a été chargée de capturer le lancé de chat avec le téléphone portable qu’elle a volé à sa mère. Puisqu’il faut un chat pour être vu, ces jeunes vont essayer désespéremment de filmer celui-ci.
Avec maladresse et décallage, ils tentent d’exister et de laisser une trace dans ce monde. A demi-mot, elle pointe un « double standard » dans l’appréciation de la situation pour laquelle Ginny est entendue. Car la sentence de Lee est trop sévère pour Ginny. Il est rejeté dans une spirale misérable dont il avait réussi à sortir et c’est, en effet, très injuste. Mais les dommages causés au chat, et à ses propriétaires, est terriblement cruel.
Face à cette situation, on ne parvient pas à trancher. Ginny nous pousse à questionner notre regard sur la jeunesse oubliée des banlieues. Jirkuff appuie avec force la subtilité de la situation de la petite Ginny. Son propos contraste avec l’image des banlieusards montrée par les médias qui est bien souvent manichéenne et superficielle.
Orane Caens
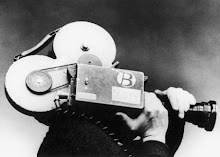
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire