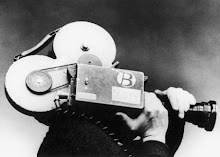Le cœur de Paris
Le cœur de Parisest un projet de Christophe Girard, qui est l’adjoint à la culture d’Anne Hidalgo. C’est une œuvre de l’artiste Franco-Portugaise Joana Vasconcellos, âgée de 47 elle a à son actif de nombreuses installations dont le
cœur de Vianaaussi appelé
cœur indépendant rougequi ressemble beaucoup à l’œuvre dont nous allons parler aujourd’hui
A travers cette œuvre artistique, l’artiste témoigne de son amour pour la capitale Française, Paris. La pièce est posée comme un panneau de signalisation, au milieu du trottoir, le cœur est posé sur un long mât de 5 mètres de haut et est composé d’environ 3 800 azulejos qui est un ensemble de carreaux de faïence décorés typique d’Espagne et du Portugal. Ils ont été peints à la main par des artisans portugais, ce qui est un énorme travail manuel. L’œuvre tourne sur elle-même, s’allume et s’éteint au rythme des battements d’un cœur humain.
L’installation fut inaugurée le 14 février 2019 à 18h30 jour de la saint Valentin, par Christophe Girard et Éric Lejoindre qui est le maire du XVIIIe arrondissement de Paris, là où se situe l’œuvre. Il faut savoir qu’il n’y a pas que l’artiste et la ville qui ont mené ce projet, mais aussi des habitants et des conseils de quartiers ont participé à la rédaction du cahier des charges.
Une œuvre qui ouvre les débats
Au de-là du geste esthétique il y a aussi une intention politique, en effet il s’agit d’un quartier populaire le long de la ligne 3 du tramway ou l’accès à la culture est limité. Avec cette œuvre, des débats s’ouvrent et le sens critique s’éveille.
Le prix de l’œuvre fait débat, en effet elle a couté le prix onéreux de 650 000 €, à 60% fiancés par la ville de Paris et le reste financés par l’État. Le cœur de l’artiste est dans une continuité d’œuvres, 24 au total qui seront disposé le long de la ligne 3 du tramway, le budget pour la réalisation est de plus de 17 millions d’euros. Aujourd’hui une dizaine ont été installées, des œuvres de Bruno Peinado, de Sylvie Auvray et de Pascale Marthine Thavou s’y trouvent.
Nous allons nous pencher sur le cœur de Parisqui a fait polémique et nous demander pourquoi cette œuvre a fait autant de débat autour d’elle.
« Au milieu de la délinquance, des trafics de drogue, des agressions, de la saleté épouvantable, des graffitis, des embouteillages dû à la conception inapte des carrefours, la mairie de Paris trouvé 650 000€ pour cette horreur ? Mais bon sang, tous ces quartiers sont déjà abominables de laideur et cette mairie toxique continue ces dépenses surréalistes ? »
L’œuvre fait débat au sein de Paris, tandis que certaine personne pense que l’art n’est pas une chose obligatoire dans l’environnement urbain et que l’État devrait privilégier la rénovation des quartiers populaire d’autre au contraire sont pour l’expansion de l’art dans tous les quartiers afin de toucher un maximum de personnes et de les ouvrirent à un milieu qui ne leurs sont pas prédestiné.
Il est vrai que l’on pourrait trouver ça curieux dans une première approche de l’œuvre de la trouver à cet emplacement, mais il faut se rappeler que l’artiste a voulu montrer son amour de Paris, il nous dit donc que ce qu’il aime dans la capitale ce n’est pas uniquement les « beaux quartiers », qui sont très touristique où on y trouve aussi de nombreuses œuvres artistiques et historiques, qui accueille la plupart du temps des personnes d’une classe sociale plus élevé que la moyenne parisienne. Ce que l’artiste aime de Paris est la ville dans son entièreté, les quartiers huppés tout comme les moins prestigieux, ça diversité qui lui donne ce charme particulier, diversité qui pourrait être représenter dans l’œuvre ici par les 3 800 azulejos qui pourrait symboliser une multitude de personnes qui forme un tous unis et solidaires.
Ce cœur qui s’allume et s’éteint à la vitesse d’un cœur humain cela pourrait signifier alors deux choses, soit le cœur de l’artiste qui bat pour Paris et qui est ça ville de cœur, ce qui serait l’explication la plus logique et la première à laquelle on pense ou alors cela pourrait être le rythme des battements de la ville elle-même. Cela voudrait donc dire que la ville vit, de plus l’avoir placé dans ce quartier voudrait donc aussi dire que c’est ici et nulle part ailleurs, dans ce quartier mis à l’écart en quelque sorte du point de vue culturel que la ville vie véritablement et pleinement, dans ce quartier chaleureux et convivial.
La couleur rouge de l’œuvre sur cette sorte de « bâton » doré nous fait penser à un rapport enfantin, comme les sucettes en forme de cœur que l’on a tous eux. En voyant cette œuvre nous avons donc un retour en enfance, un sentiment de nostalgie et de bonheur. C’est une œuvre qui trouve son sens en chacun et prouve une fois de plus que l’art est accessible à tous et qu’il peut même parler aux enfants. De plus dans cet environnement qui semble austère, gris, l’installation ressort beaucoup plus, elle se fait remarquer et le monde la regarde en souriant. Certes elle dénote avec le paysage mais cela la met encore plus en valeur.
Cette œuvre nous pose donc la question de l’amour, de la solidarité mais aussi de notre enfance nostalgique qui nous tient tous à cœur.
Juliette Letemplier, MCA1